HISTORIQUE DE LA SAINTE BIBLE (chrétienne)
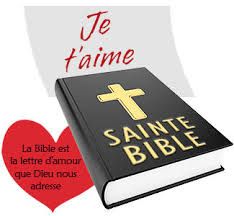
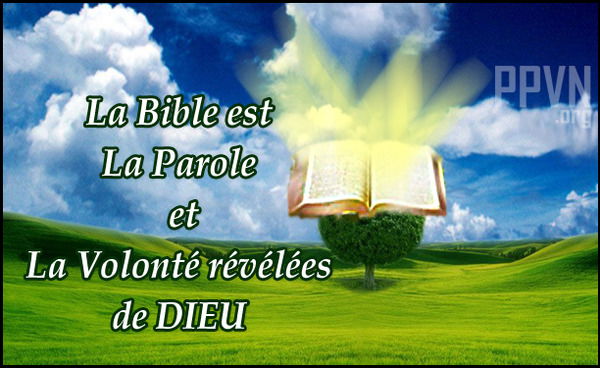
INDEX DES LIVRES DE LA SAINTE BIBLE : Version Bible Catholique Crampon 1923 ("BCC 1923)
Ancien Testament | Nouveau TestamentLes EvangilesLes Epîtres de PaulLes autres Epîtres | |
| Le PentateuqueLes livres historiquesLes Hagiographes | Les Prophètes | |
HISTORIQUE DE LA SAINTE BIBLE
https://www.lirelabible.net/histoire.php#2.A
INTRODUCTION
40 auteurs ont écrit la Bible sur une période de 1 500 ans. Ces rédacteurs de la Bible ont écrit parce qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit (voir 2 Timothée 3:16-17).
Moïse a été la première personne à écrire des portions de l'Écriture tandis que Jean, le disciple de Jésus, a été le dernier. D'autres personnes célèbres qui ont écrit la Bible incluent : Daniel, Pierre, Paul, Jonas, Isaïe, Salomon et David.
Le nombre de livres de la Bible est de :
66 livres ou 73 livres si on inclut les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament.
L'Ancien Testament contient : 39 livres ou 46 livres si on y inclut les livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament.
Le Nouveau Testament contient : 27 livres.
L’Ancien Testament catholique et orthodoxe contient sept Livres non inclus dans le Tanakh. Ils sont appelés « Livres deutérocanoniques » (littéralement « canonisés secondairement » c'est-à-dire canonisés ultérieurement). Ils sont tirés de la Septante, version grecque étendue du Tanakh. Ainsi, dans les Bibles chrétiennes, les Livres de Daniel et d'Esther peuvent contenir des textes deutérocanoniques, n'ayant été inclus ni dans le canon juif ni dans le canon protestant.
Par-delà les auteurs humains, l’auteur de la Bible est avant tout Dieu lui-même. 2 Timothée 3.16 nous dit que la Bible est « inspirée » de Dieu. Dieu a supervisé les auteurs humains de la Bible de manière à ce que, tout en conservant leur propre style d’écriture et personnalité, ils écrivent exactement ce qu’il avait prévu. Mais la Bible n’a pas été dictée par Dieu : elle a été parfaitement inspirée par lui et sa rédaction, entièrement dirigée par lui.
Humainement parlant, la Bible a été écrite par une quarantaine d’hommes provenant d’horizons très divers, sur une période de 1 500 ans. Ésaïe était un prophète, Matthieu un collecteur d’impôts, Jean un pêcheur, Paul un fabricant de tentes, Moïse un berger et Luc un médecin. Bien qu’elle ait été écrite par différents auteurs sur une période de 15 siècles, la Bible ne se contredit pas et ne comporte aucune erreur. Les auteurs écrivent d’un point de vue différent, mais ils proclament tous le seul vrai Dieu et un seul chemin pour le salut : Jésus-Christ (Jean 14.16, Actes 4.12). Peu de livres de la Bible mentionnent leur auteur.
Il y eut sans doute très tôt des textes en partie écrits, en partie transmis oralement, on ne peut trancher précisément.
Nous savons en effet que l’écriture existait bien longtemps avant Moïse, sous des formes diverses : pictogrammes en Mésopotamie, à Sumer (le pays d’Ur, d’où sortit Abraham) dès 3000 BC , hiéroglyphes en Égypte dès les débuts de la civilisation égyptienne.
L’écriture alphabétique quant à elle est apparue sans doute en Phénicie ou dans la région du Sinaï... juste avant l’époque de Moïse (vers 1500 BC).
Peut-être déjà Abraham, par exemple, a-t-il fourni et transmis de premiers matériaux décrivant son expérience et sa vie. Les textes d’alors pouvaient être gravés sur la pierre, ou écrits sur des tablettes d’argile.
Mais quoi qu’il en soit, le texte biblique proprement dit commence avec Moïse. Il fut inspiré par le Seigneur pour transcrire ces premiers matériaux éventuels, et les nouvelles révélations qu’il recevait. Le texte biblique, celui qui est inspiré de Dieu et qui fait autorité est en effet à distinguer des moyens utilisés, de l’état d’esprit ou même du fait que l’auteur comprend ou non la profondeur de ce qu’il écrit.
Ainsi Balaam, qui pourtant n’aurait sans doute pas voulu que la bénédiction de Dieu soit sur Israël, a-t-il lui aussi, très indirectement, fournit des matériaux à Moïse, qui, lui, a reçu de Dieu la pleine inspiration pour les utiliser (Nb 23).
A chaque époque, le peuple d’Israël a de même reconnu que certains écrits prophétiques, historiques ou poétiques font partie en fait du même livre : le livre de Dieu.
La BIBLE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
La Bible est un ensemble de textes sacrés pour les juifs et les chrétiens.
Les diverses confessions peuvent inclure des livres différents dans leurs canons, dans un ordre différent.
La Bible rassemble une collection d’écrits très variés :
récits des origines,
textes législatifs,
récits historiques,
textes sapientiaux (« Sagesse » - voir Livre de la Sagesse),
prophétiques,
poétiques,
hagiographies (écriture de la vie et/ou de l'œuvre des saints),
épîtres
dont la rédaction s’est échelonnée entre :
le viiie siècle av. J.-C. et le iie siècle av. J.-C. pour l'Ancien Testament,
et la deuxième moitié du ier siècle, voire le début du iie siècle pour le Nouveau Testament.
La Bible hébraïque se nomme en hébreu « TaNaKh » (תנ״ך), acronyme formé à partir des titres de ses trois parties constitutives :
la Torah (la Loi) -- (c'est-à-dire « doctrine », « enseignement », mais aussi « Loi » (ce qui explique que le terme ait été traduit en grec par νόμος/nomos), c'est parce qu'ils renferment, outre des récits « historiques », un ensemble de prescriptions (religieuses, rituelles, culturelles, juridiques, etc.) qui constituent les bases du judaïsme. Les lois alimentaires (cacherout) énoncées dans le chapitre 11 du Lévitique en sont un exemple parmi d'autres).
les Nevi'im (ou Nəḇî'îm) (les Prophètes) -- « Livres prophétiques » ou « Livres des Prophètes » et
les Ketouvim (les Écrits).
Dans les bibles juives, on retrouve cet ordre, caractérisé par l’appellation « TaNaKh » où l’on reprend les premières lettres de chacune des parties : T(orah)N(evi'im)K(etouvim).
La Bible hébraïque est écrite en hébreuN 2 avec quelques passages en araméen. Ce canon, fixé par les massorètes, se compose en détail des parties suivantes11 :
La Torah ou Loi (Le Pentateuque : 5 Premiers livres de Moise) :
Bereshit (Genèse),
Shemot (Exode),
Vayiqra (Lévitique),
Bamidbar (Nombres) et
Devarim (Deutéronome).
Les Nevi'im ou « Prophètes » (Les livres prophétiques) :
Prophètes « antérieurs » (Les « premiers prophètes ») :
Prophètes « postérieurs » (Les «derniers Prophètes ») :
Les « douze (12) petits prophètes » ou XII (idem) :
Les Ketouvim (Les autres Écrits) :
Les livres poétiques :
Les cinq rouleaux :
Prophétie :
Daniel ;
Histoire :
Moïse écrit le Pentateuque -- (Le Pentateuque est chez les chrétiens l'ensemble des cinq (5) premiers livres de la Bible. Pour les juifs, ces cinq (5) livres constituent la Torah) --, et le peuple prend tout de suite, conduit par Dieu, le sens de l’importance de ces textes, paroles de Dieu.
(Pentateuque : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentateuque)
Chronologie du Pentateuque (les 5 premiers livres de Moise (ou "la Torah") )
Le Pentateuque est chez les chrétiens l'ensemble des cinq (5) premiers livres de la Bible. Pour les juifs, ces cinq livres constituent la Torah. Si, dans la religion juive, ils portent le nom de Torah, c'est-à-dire « doctrine », « enseignement », mais aussi « Loi » (ce qui explique que le terme ait été traduit en grec par νόμος/nomos), c'est parce qu'ils renferment, outre des récits « historiques », un ensemble de prescriptions (religieuses, rituelles, culturelles, juridiques, etc.) qui constituent les bases du judaïsme. Les lois alimentaires (cacherout) énoncées dans le chapitre 11 du Lévitique en sont un exemple parmi d'autres.
Le Pentateuque est constitué de deux (2) sortes de textes : les récits historiques et les prescriptions religieuses. À part le livre de la Genèse, qui ne contient que des textes narratifs, les quatre autres alternent ces deux types de textesL 2. Les récits historiques qui constituent le Pentateuque vont de la création du monde jusqu'à la disparition de Moïse et se poursuivent dans les livres suivants (livre de Josué, livre des Juges, Premier et Deuxième livre de Samuel et Premier et Second livre des Rois) qui vont de l'installation dans la Terre Promise jusqu'à la chute de Jérusalem () et l'exil à Babylone (597/586/5824-)L 3. Les textes de loi sont au nombre de trois et sont dispersés dans le texte. Il s'agit du Code de l'Alliance du chapitre 20, verset 22 au chapitre 23, verset 19 de l'Exode, du Code de sainteté des chapitres 17 à 26 du Lévitique et du Code deutéronomique des chapitres 12 à 26 du Deutéronome. Ces groupes de lois ont été, selon la tradition, transmis par Moïse qui est l'agent de Dieu et sont donc clairement différents d'un autre texte de loi, le Décalogue qui est transmis directement par Dieu. Ces dix lois divines sont exposées deux fois dans le Pentateuque. Elles se trouvent d'abord dans le livre de l'Exode (chapitre 20 versets 2 à 17) puis dans celui du Deutéronome (chapitre 5 versets 6 à 21)L 4.
Selon 1 Rois 6 v. 1, la sortie d’Égypte se situerait alors en 1446 av. J.C., et le verset 40 d’Exode 12 permet de dire que Jacob, âgé de 130 ans, est descendu en Égypte en 1876 av. J.C. (comp. Gen. 47 v. 1, 9). L’année 966 av. J.C., celle de la construction du temple, servira de point de départ à ce tableau.
| Naissance d’Abraham | 2166 av. J.C. | (Gen. 21 v. 5; 25 v. 7) |
| Voyage vers Canaan | 2091 av. J.C. | (Gen. 12 v. 4) |
| Naissance d’Isaac | 2066 av. J.C. | (Gen. 21 v. 5) |
| Naissance de Jacob | 2006 av. J.C. | (Gen. 25 v. 26) |
| Mort d’Abraham | 1991 av. J.C. | (Gen. 25 v. 7) |
| Naissance de Joseph | 1915 av. J.C. | (Gen. 30 v. 22-24) |
| Mort d’Isaac | 1886 av. J.C. | (Gen. 35 v. 28) |
| Joseph devant le Pharaon | 1885 av. J.C. | (Gen. 41 v. 46) |
| Jacob descend en Égypte | 1876 av. J.C. | (Gen. 47 v. 9) |
| Mort de Jacob | 1859 av. J.C. | (Gen. 47 v. 28) |
| Mort de Joseph | 1805 av. J.C. | (Gen. 50 v. 26) |
| Naissance de Moïse | 1526 av. J.C. | (Deut. 34 v. 7) |
| Fuite de Moïse en Madian | 1486 av. J.C. | (Actes 7 v. 23) |
| Sortie d’Israël hors d’Égypte | 1446 av. J.C. | (Ex. 12 v. 40; Actes 7 v. 30) |
| Mort de Moïse ; Entrée d’Israël en Canaan | 1406 av. J.C. | (Deut. 34 v. 7; 1 Rois 6 v. 1) |
Source https://www.bibliquest.net/Remmers/Remmers-Chronologie_biblique.htm
La Bible hébraïque est traduite en grec ancien à Alexandrie : la Septante.
Cette version — la Septante — est utilisée au tournant du ve siècle par Jérôme de Stridon pour compléter sa traduction latine de la Bible — la Vulgate — à partir de l'hébreu
puis, au ixe siècle, par les « apôtres des Slaves » Cyrille et Méthode pour traduire la Bible en vieux-slave.
Septante : La Septante (LXX, latin : Septuaginta) est une traduction de la Bible hébraïque en grec koinè. Par extension, on appelle Septante la traduction en grec de l'Ancien Testament (ou Écritures hébraïques).
Le judaïsme n'a pas adopté la Septante, choisissant plutôt le texte hébreu et des traductions grecques ou araméennes (Targoum) plus proches selon leurs autorités dudit texte.
Selon une tradition rapportée dans la Lettre d'Aristée (iie siècle av. J.-C.), la traduction de la Torah aurait été réalisée par 72 (septante-deux) traducteurs à Alexandrie, vers 270 av. J.-C., à la demande de Ptolémée II. Selon Philon d'Alexandrie, ces 72 érudits auraient traduit séparément l'intégralité du texte mais, au moment de comparer leurs travaux, auraient constaté avec émerveillement que les 72 traductions étaient toutes identiques.
Légende sur l'origine de la Septante
La légende prétend que très vite après la fondation d'Alexandrie par Alexandre le Grand en -331, une diaspora juive s'y développe fortement, en particulier autour du Palais royal, à tel point que deux des cinq quartiers de la cité sont réservés aux « descendants d'Abraham ». Les Juifs continuent à y parler la langue hébraïque et à étudier les textes de l'Ancien Testament. Le culte synagogal est public et les Grecs se montrent curieux des « sagesses barbares ». Quelques-uns gagnent le statut reconnu de « craignant-Dieu » (signalés dans les Actes des Apôtres) en cela qu'ils suivent les préceptes du judaïsme, au moins les 7 lois des fils de Noé, sans aller jusqu'à une conversion qui implique la circoncision.
Selon la légende relatée dans la lettre d'Aristée (iie siècle av. J.-C.), la Septante serait due à l'initiative du fondateur de la Bibliothèque d'Alexandrie, Démétrios de Phalère, ancien oligarque d'Athènes. Vers 270 av. J-C., celui-ci aurait en effet suggéré à Ptolémée II (au pharaon selon Aristée) d'ordonner la traduction en grec de tous les livres israélites, textes sacrés et narrations profanes, écrits en hébreu. Le Lagide, souverain hellénistique le plus cultivé de son temps, apparaît également soucieux de connaître les règles des divers peuples qui lui sont assujettis dans le cadre d'une réorganisation de son royaume. Les savants juifs au nombre de 72 (six de chacune des douze tribus d'Israël) auraient été chargés de ce travail qui, en leur honneur, porte le nom de Version des Septante. La tradition prétend que le souverain sacrificateur de Jérusalem, Éléazar, n'aurait accédé à la demande de Ptolémée II qu'à une condition : l'affranchissement des Juifs de Judée, que Ptolémée Ier avait fait prisonniers et réduits à l'esclavage en Égypte.
Une légende similaire est relatée par Philon d'Alexandrie1.
Dans son récit, qui n'est pas nécessairement historiquement fiable, Flavius Josèphe arrondit le nombre de traducteurs à 702, d'où le nom retenu par la postérité.
Tribus | Traducteurs de la Septante - de l'hébreu au grec3 |
|---|---|
Réuben | Josephus, Hezekiah, Zechariah, John, Ezekiel, Elisha. |
Siméon | Judah, Simon, Samuel, Addai, Mattathias, Shalmi. |
Lévi | Nehemiah, Joseph, Theodosius, Basa, Adonijah, Daki. |
Judah | Jothan, Abdi, Elisha, Ananias, Zechariah, Hilkiah. |
Issachar | Isaac, Jacob, Jesus, Sambat/ Sabbateus, Simon, Levi. |
Zabulon | Judah, Joseph, Simon, Zechariah, Samuel, Shamli. |
Gad | Sambat, Zedekiah, Jacob, Isaac, Jesse, Matthias. |
Asher | Theodosius, Jason, Joshua, John, Theodotus, Jothan. |
Dan | Abraham, Theophilus, Arsam, Jason, Jeremiah, Daniel. |
Naphtali | Jeremiah, Eliezer, Zechariah, Benaiah, Elisha, Dathi. |
Joseph | Samuel, Josephus, Judah, Jonathan, Dositheus, Caleb. |
Benjamin | Isalus, John, Theodosius, Arsam, Abijah, Ezekiel. |
(Septante - Pour plus d'informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Septante)
Vulgate : La Vulgate est une version latine de la Bible, composée d'une part, en majorité, des traductions faites à la fin du ive siècle par Jérôme de Stridon, et d'autre part de traductions latines indépendantes de ce dernier appelées Vetus Latina (« vieille [bible] latine »).
Jérôme commence son édition par les quatre Évangiles, en révisant et adaptant une version Vetus Latina de ces derniers qui était couramment en usage en Occident. Il poursuit avec une traduction complète à partir de l'hébreu de la totalité du Tanakh et traduit certains livres deutérocanoniques à partir de versions grecques de la Septante ou de l'araméen. Jérôme traduit également le livre des Psaumes trois fois : une fois en révisant une Vetus Latina, une fois depuis le grec et une autre depuis l'hébreu. Aux traductions de Jérôme s'ajoutent par la suite, indépendamment de Jérôme, certaines Vetus Latina de livres bibliques qu'il n'a pas traduits, pour former ce qui est appelé la Vulgate.
Diffusée essentiellement en Occident, la Vulgate connaît plusieurs versions et évolutions, dont celles dues à Alcuin au viiie siècle ou encore à Érasme au xvie siècle. En 1454, Gutenberg fait de la Vulgate le premier livre imprimé en Europe, c'est la Bible de Gutenberg. La Vulgate est fixée par le pape Clément VIII en 1592, dans une version dite « sixto-clémentine (en) » qui fait autorité dans l’Église catholique romaine jusqu'en 1979 ; la révision de la Vulgate pour l'Église catholique latine promulguée en 1979 par Jean-Paul II est appelée la « Néo-Vulgate (en) ».
Terminologie
Le terme vulgate vient du latin vulgata, qui signifie « rendue accessible, rendue publique », lui-même de vulgus, qui signifie « la foule ». Le terme Vulgate (vulgata) appliqué à la version latine de la Bible est anachronique concernant le travail de Jérôme de Stridon : ce n'est qu'à partir du début du xvie siècle qu'il sert à désigner habituellement les bibles latines dont les versions ont été plus ou moins stabilisées depuis l'édition faite à Mayence vers 1450. Afin d'identifier ce texte stabilisé, le Concile de Trente de 1546 utilise l'expression « vetus et vulgata editio »1.
Quand Jérôme ou son contemporain Augustin d'Hippone utilisent le terme vers le ive siècle, c'est plutôt pour désigner la Bible grecque commune non révisée — ou les traductions latines antérieures à Jérôme et que celui-ci juge d'ailleurs inexactes2 — connue sous le nom actuel de Vetus Latina (« vieille [bible] latine »)1.
Enfin, le texte connu sous le nom de Vulgate de nos jours n'était toujours pas fixé au viiie siècle ni son usage réellement « vulgarisé » : celui-ci commencera à réellement se répandre aux alentours de 850, notamment grâce à la diffusion des bibles carolingiennes illustrées dites « Bibles de Tours », la Bible de Moutier-Grandval ou encore la Bible Vivien1
(Vulgate - Pour plus d'informations : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgate)
La Bible chrétienne, qui connaît plusieurs canons selon les époques et les confessions, se compose de deux (2) parties :
L' Ancien Testament ( " AT " ), qui reprend le Tanakh (Bible hébraïque) tel quel ou augmenté d'un certain nombre de livresN 1, l'Ancien Testament, dans le christianisme est la partie de la Bible antérieure à Jésus-Christ. Pour les chrétiens, l'Ancien Testament se limite à trente-neuf (39) livres sans compter les livres deutérocanoniques, ou, à quarante-six (46) livres si on y inclut les livres deutérocanoniques. L'Ancien Testament forme la première (1ère) partie de la Bible1 ; et
Le Nouveau Testament ( " NT " ) commun à la plupart des Églises chrétiennes et regroupant les écrits relatifs à Jésus-Christ et à ses disciples. Le Nouveau Testament se limite à vingt-sept (27) livres et, forme la deuxième (2ème) partie de la Bible.
Il s'agit :
des quatre Évangiles canoniques,
des Actes des Apôtres,
des Épîtres, et
de l'Apocalypse.
N.B. :
L’ Ancien Testament catholique et orthodoxe contient sept (7) Livres non inclus dans le Tanakh. Ils sont appelés « Livres deutérocanoniques » (lit. « canonisés secondairement » c'est-à-dire canonisés ultérieurement). Ils sont tirés de la Septante, version grecque étendue du Tanakh. Ainsi, dans les Bibles chrétiennes, les Livres de Daniel et d'Esther peuvent contenir des textes deutérocanoniques, n'ayant été inclus ni dans le canon juif ni dans le canon protestant.
L' Ancien Testament se nomme en koinè (grec) Παλαιὰ Διαθήκη / Palaià Diathếkê et en latin Vetus Testamentum1,2,3. Le mot latin testamentum (« testament ; témoignage ») est lui-même traduit du grec διαθήκη / diathếkê (« testament, contrat, convention »). Dans un sens religieux, « testament » signifie « alliance »3
Le Nouveau Testament (en grec ancien : Ἡ Καινὴ Διαθήκη / Hê Kainề Diathếkê) est l'ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus et à l'enseignement de ses premiers disciples qui ont été reconnus comme « canoniques » par les autorités chrétiennes au terme d'un processus de plusieurs siècles. La liste des textes retenus par l'Église pour former le Nouveau Testament a été fixée en 363 lors du concile de Laodicée ; cependant, elle ne comprenait pas encore le texte de l'Apocalypse. Le mot « testament » vient du latin testamentum, « testament, témoignage », lui-même issu du grec διαθήκη (diathếkê), « testament, contrat, convention ». Le mot grec a un sens plus large que le mot latin, puisqu'il comporte la notion de contrat. Aussi certains préfèrent-ils le traduire par « alliance ». Pour le christianisme, la Bible se compose de l'Ancien Testament (c'est-à-dire la Bible hébraïque, le Tanakh) et du Nouveau Testament.
ORIGINES DE LA BIBLE
Ce que les chrétiens appellent Ancien Testament provient d'un ensemble de textes religieux rédigés pour sa très grande majorité à l'origine en hébreu et qui nous est parvenu sous la forme de copies4.
Cette Bible hébraïque est traduite en grec à partir du milieu du iiie siècle av. J.-C., en commençant par le Pentateuque (Torah). Cette traduction grecque, connue sous le nom de Septante, est largement utilisée par la communauté juive d'Égypte3. Au fil du temps, elle s'étoffe d'autres livres.
Vers 132 av. J.‑C., la Loi et les Prophètes sont déjà traduits en grec.
D'autres livres (notamment les Écrits) sont ensuite encore traduits de l'hébreu ou de l'araméen,
mais certains livres sont aussi directement rédigés en grec, si bien que les textes religieux en hébreu et en grec divergent5.
C'est à partir du milieu du iie siècle que les chrétiens appellent cette Bible juive « Ancien Testament » pour le distinguer des écrits réunis entretemps dans le Nouveau Testament6 (tous les livres du Nouveau Testament ont été rédigés en grec)3. C'est donc à partir du iie siècle que l’Ancien Testament est constitué en canon par les chrétiens.
L'Église chrétienne primitive se fonde sur la version grecque des Septante.
C'est pourquoi son Ancien Testament comprend, en plus des livres du Tanakh juif, d'autres livres ainsi que quelques compléments dans les livres d'Esther, Daniel…
Ces textes sont appelés livres deutérocanoniques par l'Église catholique.
Les Églises orthodoxes, qui les reconnaissent comme canoniques, ne les désignent par aucun terme particulier.
Les Communautés ecclésiales protestantes ont un Ancien Testament calqué sur la Bible hébraïque et ne reprennent pas ces livres, qu'elles considèrent comme apocryphes.
La version latine de l'Ancien et du Nouveau Testaments7 en usage dans l'Église est établie par saint Jérôme de 392 à 410. Elle porte le nom de Vulgate3.
ÉTYMOLOGIE (origine des mots) : mot « bible » et mot « Testament »
Le mot « bible » vient du grec ancien biblos ou biblion1 correspondant à l'hébreu sépher2 — « livre » — qui a donné τὰ βιϐλία (ta biblia), un substantif au pluriel qui signifie « les livres », soulignant son caractère multiple, qui est traité par les auteurs médiévaux en latin comme un féminin singulier, biblia, avec pour pluriel bibliae2, par lequel il passe dans la langue française3.
Le mot « Testament », traduit du latin testamentum, correspond lui au mot grec διαθήκη, diathêkê, qui signifie « convention » ou « disposition écrite »4 avant de recouvrir une acception littéraire spécifique au sens de « testament philosophique », un sens que retient la Septante pour traduire le terme hébreu berith, « alliance », qui correspond pourtant davantage au grec sunthêkê5. Le déplacement sémantique du terme en tant que « testament » littéraire s'opère chez les auteurs chrétiens dès le iiie siècle6, traduit alors par le terme juridique latin testamentum qui est repris ensuite dans toutes les langues7.
DATES DE RÉDACTION
La rédaction des différents ouvrages qui constituent le corpus néotestamentaire s'étale sur une période comprise entre 50N 1 et 130N 2 . Une partie de cette littérature est organisée sous forme canonique au ive siècle et prend alors le nom de « Nouveau Testament »5.
Chapitres, versets et division des Livres
Alors que les Chrétiens lisent la Bible dans des livres, les Juifs la lisent (du moins pour l'usage rituel) dans un rouleau. La division en chapitres et versets n'a donc aucune signification dans la tradition juive, qui divise la Torah en parashiot (péricopes, sections), elles-mêmes divisées en sept parties thématiques, et les autres Livres selon les épisodes narratifs. La division en chapitres et versets a néanmoins été ajoutée dans la plupart des éditions modernes du Tanakh, afin de faciliter la localisation et la citation de ceux-ci. La division de Samuel, Rois, et Chroniques en I et II est également indiquée sur chaque page de ces livres, afin d'éviter toute confusion dans la capitation de ces Livres, celle-ci suivant la tradition textuelle chrétienne. L'adoption de la capitation chrétienne par les Juifs commença en Espagne, aux alentours du xiiie siècle, en partie du fait des disputations, des débats œcuméniques forcés dans le contexte de l'Inquisition espagnole naissante. Les débats requéraient en effet un système de citation biblique commun. Du point de vue de la tradition textuelle juive, la division en chapitres est non seulement une innovation étrangère sans aucun fondement dans la messora, mais elle est également fort critiquable car :
la division en chapitres reflète souvent l'exégèse chrétienne de la Bible ;
quand bien même ce ne serait pas le cas, elle est artificielle, divisant le Texte en des endroits jugés inappropriés pour des raisons littéraires ou autres.
Introduction des 8 familles de traduction de la bible :
Famille Segond
Évangélique
Protestante
Œcuménique ou Interconfessionnelle
Catholique
Juive
Libérale
Tendancieuse
Pour comprendre la différence entre chacune des familles, voir :
Source : https://www.bibliorama.org/introduction-du-classement-des-bibles-en-8-familles/
CHRONOLOGIE DE LA FORMATION DE :
L' ANCIEN TESTAMENT
Voici la liste des livres de l'Ancien Testament avec les noms de leurs auteurs présumés et la date estimée de leur rédaction (de l’avis de la plupart des exégètes) :
(N.B. Les dates de ce tableau diffèrent légèrement du tableau ci-bas).
| groupe de livres selon la classification | Livre | Auteur(ent s'agit d'une supposition historique) | Date (environ) | Observations | |
| TORAH (Pentateuque) | Genèse | Moïse | 1450 à 1400 | Les livres ultérieurs de l’AT font allusion à ce groupe de livres comme existant déjà et formant un tout cohérent (Jos 1/5-8 ; IICh 34/14 ; IR 14/16 ; IIR 23/2 ; Ne 8/1 , 3,18) attestant ainsi sa plus grande ancienneté. | |
| Exode | Moïse | 1450 à 1400 | |||
| Lévitique | Moïse | 1450 à 1400 | |||
| Nombre | Moïse | 1450 à 1400 | |||
| Deutéronome | Moïse | 1450 à 1400 | |||
| NEBIIM (Prophètes) | Premiers prophètes | Josué | Josué | 1370(env.) | Ces livres étaient connus pendant l’exil. |
| Juges | (Samuel ?) | 1050 (env.) | |||
| 1 et 2 Samuel (un seul livre) | (Samuel, Saül, David ) | 1030 à 950 (env.) | |||
| 1 et 2 Rois (un seul livre) | (Jérémie ?) | vers 600 | |||
| Derniers prophètes | Esaïe | Esaïe | 740 à 680 | Ezéchiel, Aggée, Zacharie et Malachie ont été ajoutés au Canon dès le retour des juifs de Babylone | |
| Jérémie | Jérémie | 625 à 580 | |||
| Ézechiel | Ézechiel | vers 590 | |||
| Osée | Osée | 760 à 710 | |||
| Joël | Joël | entre 850 et 700 ? | |||
| Amos | Amos | 780 à 755 | |||
| Abdias | Abdias | 585 | |||
| Jonas | Jonas | 800 | |||
| Michée | Michée | 740 | |||
| Nahum | Nahum | 700 à 615 | |||
| Habakuk | Habakuk | 627 à 586 | |||
| Sophonie | Sophonie | 630 à 620 | |||
| Aggée | Aggée | 520 | |||
| Zacharie | Zacharie | 520 à 518 | |||
| Malachie | Malachie | 450 à 400 | |||
| KETUBIM (Écritures ou Hagiographes) | Livres poétiques | Psaumes | (rassemblés par Esdras ?) David et autres auteurs | 1050 et après | Ces livres ont été inclus au canon plus tard, après le retour. Ils en faisaient clairement partie au moment de la traduction par les Septantes. |
| Proverbes | Salomon, Agur, Lemuel | 950 à 900 | |||
| Job | Inconnu | Incertain | |||
| MEGUILLOTH (Les Cinq Rouleaux) | Cantique des Cantiques | (Salomon) | 950 | ||
| Ruth | (Samuel ?) | 1050 (env.) | |||
| Lamentations de Jérémie | Jérémie | 586 | |||
| Écclésiaste | Salomon | 950 | |||
| Esther | (Mardochée ?) | 460 | |||
| Livres historiques | Daniel | Daniel | 590 à 535 | ||
| Esdras et Néhémie (un seul livre) | Esdras | 538 à 480 | |||
| 1 et 2 Chroniques | (Esdras< ?) | vers 500 | |||
Source : https://www.lirelabible.net/histoire.php#annexe2
Les noms (ci-dessous) entre parenthèses sont ceux sous lesquels les Livres sont connus dans le monde chrétien :
(La Torah (תורה « Loi ») également connue sous le nom de Pentateuque (ou les 5 premiers livres de Moise) constitue la première (1ère) partie du TaNaKh).
TaNaKh :
Torah (Pentateuque ou, les 5 premiers livres d Moise)
Bereshit (בראשית, « Au commencement » / Genèse) ;
Shemot (שמות, « Noms » / Exode) ;
Vayiqra (ויקרא, « Et Il appela » / Lévitique) ;
Bamidbar (במדבר, « Dans le désert » / Nombres) ;
Devarim (דברים, « Paroles » / Deutéronome).
Les Nevi'im (נביאים, « Prophètes ») sont :
Neviim rishonim (נביאים ראשונים, « Premiers prophètes »)
6. Yehoshoua (יהושע, Josué)
7. Shoftim (שופטים, Juges)
8. Shemouel (שמואל, Livres de Samuel – I et II)
9. Melakhim (מלכים, Livres des Rois - I et II)
Neviim aharonim (נביאים אחרונים, « Derniers prophètes »)
10. Yeshayahou (ישעיהו, Isaïe)
11. Yrmeyahou (ירמיהו, Jérémie)
12. Yehezqel (יחזקאל, Ézéchiel)
13. Trei Assar (תרי עשר)
I. Hoshéa (הושע, Osée)
II. Yoël (יואל, Joël)
III. Amos (עמוס, Amos)
IV. Ovadia (עובדיה, Abdias)
V. Yona (יונה, Jonas)
VI. Mikha (מיכה, Michée)
VII. Nahoum (נחום, Nahum)
VIII. 'Havaqouq (חבקוק, Habacuc)
IX. Tsephania (צפניה, Sophonie)
X. Haggaï (חגי, Aggée)
XI. Zekharia (זכריה, Zacharie)
XII. Malakhi (מלאכי, Malachie)
Les Ketouvim (כתובים, « Écrits ») consistent en :
14. Tehilim (תהילים, « Louanges » / Psaumes)
15. Mishlei (משלי, « Paraboles » / Proverbes)
16. Iyov (איוב, Job)
17. Shir Hashirim (שיר השירים, Cantique des cantiques)
18. Routh (רות, Ruth)
19. Eikha (איכה, « Où » / Lamentations)
20. Qohelet (קהלת, « Prédicateur » / Ecclésiaste)
21. Esther ((אסתר
22. Daniel (דניאל)
23. Ezra-Nehemia (עזרא ונחמיה, Ezra wuNekhem'ya, Esdras et Néhémie)
24. Divrei Hayamim (דברי הימים, Chroniques - I et II)
Source : Tanakh : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanakh
CHRONOLOGIE DE LA FORMATION DE :
L’ ANCIEN ("AT") et du NOUVEAU Testament ("NT ")
Voici la liste des livres de la Bible, avec les noms de leurs auteurs présumés et la date estimée de leur rédaction (de l’avis de la plupart des exégètes) :
(N.B. Les dates de ce tableau diffèrent légèrement du tableau ci-haut).
| LIVRE | AUTEUR | Date AV Jésus-Christ (environ) | Date AP Jésus-Christ (environ) |
| Genèse Exode Lévitique Nombres Deutéronome | Moïse | -1400 av. J.-C. | |
| Josué | Josué, | -1350 av.-J.-C. | |
| Juges Ruth 1 Samuel 2 Samuel | Samuel / Nathan / Gad | -1000-900 av. J.-C. | |
| 1 Rois 2 Rois | Jérémie | -600 av. J.C. | |
| 1 Chroniques 2 Chroniques Esdras Néhémie | Esdras | -450 av. J.-C. | |
| Esther | Mardochée | - 400 av. J.-C. | |
| Job | Moïse | -1400 av. J.-C. | |
| Psaumes | différents auteurs, la plupart de David | -1000-400 av. J.-C. | |
| Proverbes Ecclésiaste Cantique des Cantiques | Salomon | -900 av. J.-C. | |
| Esaïe | Esaïe | -700 av. J.-C. | |
| Jérémie Lamentations | Jérémie | -600 av. J.-C. | |
| Ézéchiel | Ézéchiel | -550 av. J.-C. | |
| Daniel | Daniel | -550 av. J.-C. | |
| Osée | Osée | -750 av. J.-C. | |
| Joël | Joël | - 850 av. J.-C. | |
| Amos | Amos | -750 av. J.-C. | |
| Abdias | Abdias | -600 av. J.-C. | |
| Jonas | Jonas | -700 av. J.-C. | |
| Michée | Michée | -700 av. J.-C. | |
| Nahum | Nahum | -650 av. J.-C. | |
| Habacuc | Habacuc | -600 av. J.-C. | |
| Sophonie | Sophonie | -650 av. J.-C. | |
| Aggée | Aggée | -520 av. J.-C. | |
| Zacharie | Zacharie | -500 av. J.-C. | |
| Malachie | Malachie | -430 av. J.-C. | |
| Matthieu | Matthieu | 55 ap. J.-C. | |
| Marc | Marc | 65-70 ou 65-75 ap. J.-C | |
| Luc | Luc | 60 ap. J.-C. | |
| Jean | Jean | 90 ap. J.-C. | |
| Actes | Luc | 65 ap. J.-C. | |
| Romains 1 Corinthiens 2 Corinthiens Galates Éphésiens Philippiens Colossiens 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 Timothée 2 Timothée Tite Philémon | Paul | 50-70 ap. J.-C. | |
| Hébreux | inconnu ?? ; probablement Paul, Luc, Barnabas ou Apollos | 65 ap. J.-C. | |
| Jacques | Jacques | 45 ap. J.-C. | |
| 1 Pierre 2 Pierre | Pierre | 60 ap. J.-C. | |
| 1 Jean 2 Jean 3 Jean | Jean | 90 ap. J.-C. | |
| Jude | Jude | 60 ap. J.-C. | |
| Apocalypse | Jean | 90 ap. J.-C. | |
Source : https://www.gotquestions.org/Francais/Auteurs-Bible.html
LES PROPHÈTES
Canon juif & les prophètes
Les Nevi'im sont traditionnellement regroupés en deux ensembles :
Les Premiers Prophètes (Nevi'im Rishonim [נביאים ראשונים] - c'est-à-dire prophètes antérieurs à la chute du Premier Temple et l'exil) dont le récit s'étend de Josué aux Rois.
Les Derniers Prophètes (Nevi'im Aharonim [נביאים אחרונים] - c'est-à-dire prophètes ultérieurs à l'exil), (contenant surtout des prophéties sous forme poétique.)
L'ordre des livres du judaïsme est repris dans le protestantisme. Dans la tradition juive, les livres de Samuel et des Rois ne sont pas subdivisés en deux livres chacun. Par ailleurs, les livres des derniers prophètes étant relativement courts, ils sont regroupés en un ouvrage, appelé Trei 'Assar (les Douze petits prophètes), « petit » ne se rapportant pas à leur importance mais à la longueur des écrits.
La tradition juive compte donc un total de huit livres dans les Nevi'im (parmi 24 livres dans tout le Tanakh) :
Les premiers prophètes
Les livres des premiers prophètes couvrent l'histoire d'Israël de son installation en terre de Canaan à sa déportation à Babylone. Ils comprennent les livres suivants :
Les prophètes seconds
Le Livre d'Isaïe dans une Bible anglaise. Ces livres sont à proprement parler des prophéties : pour les croyants, ils donnent à entendre la parole de Dieu rapportée par les prophètes. Ces prophètes seconds sont eux-mêmes répartis en deux catégories, les grands prophètes :
et les petits prophètes, au nombre de douze :
Osée(הוֹשֵׁעַ [hōše`a]) | Joël(יוֹאֵל [yōel]) | Amos(עָמוֹס [`amōs]) | Abdias(עֹבַדְיָה [`obadiyah]) |
Jonas(יונה [yohnah]) | Michée(מִיכָה [mīḫah]) | Nahoum(נַחוּם [naḥūm]) | Habaquq(חֲבַקּוּק [ḥabaqūq]) |
Sophonie(צְפַנְיָה [ṣefaniyah]) | Aggée(חַגַּי [ḥaġay]) | Zacharie(זְכַרְיָה [zaḫariyah]) | Malachie(מַלְאָכִי [malāḫy]) |
Canon catholique & les prophètes
Le catholicisme ordonne lui différemment ces livres des prophètes. D'abord, le catholicisme appelle les prophètes premiers du nom de livres historiques. Il leur ajoute, entre le livre des Juges et le premier livre de Samuel :
Ruth, qui dans la Bible hébraïque se trouve dans les Ketouvim
et après le deuxième livre des Rois, une liste de livres qui dans la Bible hébraïque se trouvent dans les Ketouvim, à savoir :
et enfin, les Livres deutérocanoniques suivants :
Quant aux prophètes seconds, le catholicisme les nomme livres prophétiques. Il leur ajoute les livres suivants, qui dans la Bible hébraïque se trouvent dans les Ketouvim :
et ajoute aussi le livre deutérocanonique suivant :
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nevi%27im
LIVRES INCLUS DANS L' ANCIEN TESTAMENT
ANCIEN TESTAMENT
PSAUMES
LISTE DES LIVRES DE L' ANCIEN TESTAMENT : Canon catholique et orthodoxe
Le plan du canon de l'Ancien Testament selon la Septante est le suivant8 :
Pentateuque (Torah) : Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome
Les livres historiques : Josué, Juges, Ruth, I-II Samuel, I-II Rois, I-II Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Tobie*, Judith*, I-II Maccabées*
Les Hagiographes : Livre de Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Sagesse de Salomon*, Ecclésiastique*
Les Prophètes : Ésaïe, Jérémie, Lamentations, Baruch*, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie, Malachie
Listes des livres « deutérocanoniques » (ou « apocryphes » ou « canonisés »)
(Voir liste ci-dessous pour savoir les livres « deutérocanoniques » (ou « apocryphes ») conservés par chacune des églises).
Judith (conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
Tobie (réécrit par Saint Jérôme dans la Bible latine et conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
1er et 2elivres des Maccabées (conservés par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
Livre de la Sagesse (de Salomon) (conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
Sagesse de Sirach (Siracide ou Ecclésiastique) (conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
Baruch (conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
Lettre de Jérémie (chapitre 6 du Livre de Baruch) (conservée par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
Suzanne (chapitre 13 du Livre de Daniel) (conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes dans la Bible latine)
Bel et le Dragon (chapitre 14 du Livre de Daniel) (conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
Premier livre d'Esdras (non conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes)
3e et 4e livres des Maccabées (3e non conservé par l'Église catholique et les Églises orthodoxes, ces dernières conservent le 4e en appendice)
Psaumes de Salomon (non conservé par l'Église catholique, conservé par les Églises orthodoxes)
Ces livres figuraient dans l'Ancien Testament des Bibles orthodoxes et latines, et au concile de Trente (1545 - 1563) l'Église catholique les a encore confirmés dans le Canon des Écritures.
LISTE DES LIVRES DE L' ANCIEN TESTAMENT : Canon juif et protestant
L'ordre et l'organisation des livres ne sont pas les mêmes dans le judaïsme. Le Tanakh est divisé en trois parties
La Torah (« instruction », « enseignement », « loi »), c'est-à-dire le Pentateuque : Genèse, Exode, Lévitiques, Nombres, Deutéronome
Les Nevi'im (Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois) et prophètes postérieurs majeurs (Isaïe, Jérémie, Ézéchiel) et mineurs (Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahoum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie)
Les Ketouvim : Psaumes, Proverbes, Livre de Job, les « rouleaux » (Ruth, Cantique des Cantiques, Qohélet ou Ecclésiaste, Lamentations, Esther), Daniel, Esdras et Néhémie, 1-2 Chroniques (l'ordre des livres dans cette troisième catégorie peut varier).
Dans l'Ancien Testament, Job, Psaumes, Proverbes et Ecclésiastique (Siracide) sont placés dans les livres historiques. Ensuite viennent les livres prophétiques : six prophètes majeurs :
Isaïe : Livre d'Isaïe
Jérémie : Livre de Jérémie
Anonyme : Livre des Lamentations
Baruch9 : Livre de Baruch10
Ézéchiel : Livre d'Ézéchiel
Daniel : Livre de Daniel
et les douze petits prophètes.
Les juifs, et à leur suite les protestants, ne considèrent pas comme inspirés les livres grecs transmis uniquement par la Septante. Il s'agit du Livre de Tobie, du Livre de Judith, certains chapitres d'Esther, 1-2 Maccabées, certains chapitres de Daniel, Sagesse, Ecclésiastique (Siracide) et Baruch.
LIVRES INCLUS DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
LISTE DES LIVRES DU NOUVEAU TESTAMENT
Le Nouveau Testament comprend, selon l'ordre du canon occidental :
les quatre Évangiles canoniques (Évangiles selon Matthieu, Marc, Luc, Jean) ;
les Actes des Apôtres ;
les 13 Épîtres de Paul, dont la moitié est l'œuvre de Paul de Tarse ;
l'Épître aux Hébreux ;
d'autres épîtres, dites « catholiques » (au sens de « universelles »), attribuées à différents disciples : Simon-Pierre, Jacques le Juste, Jean de Zébédée, Jude ;
l’Apocalypse.
Le canon se limite à 27 livres par décision de l'Église au concile de Rome en 3821. Ce canon a été confirmé aux synodes régionaux de Carthage en 397 et en 419.
Jusqu'aux dernières années du ive siècle, il exclut l'Épître aux Hébreux. Cette question n'est pas traitée dans les conciles œcuméniques de la fin du siècle.
En dépit des décrets de Gélase, les littératures apocalyptiques autres que celle de Jean sont recopiées et tenues pour partie prenante du Nouveau Testament jusqu'au milieu du Moyen Âge (xiiie siècle).
Certaines Églises orthodoxes n'ont pas inclus l'Apocalypse dans leur canon2. Cette opposition aux littératures apocalyptiques a été une manifestation contre le millénarisme montaniste, attestée par Eusèbe de Césarée puis par Grégoire de Nazianze, Amphiloque d'Iconium, qui déclare à propos de l'Apocalypse3 : « Certains l'acceptent mais la plupart le disent inauthentique. » L'école d'Antioche, avec Jean Chrysostome (347-407) et Théodore de Mopsueste (393-466), s'en tient à un canon de 22 livres sans l'Apocalypse. Le concile in Trullo (692) ne règle rien3.
Classement des livres du Nouveau Testament
Le classement des livres du Nouveau Testament ne repose pas sur leur date d'écriture, qui n'est d'ailleurs pas connue avec précision. Il répond à une progression logique4 :
- la vie de Jésus, racontée selon différentes perspectives par quatre rédacteurs ;
- l'histoire des débuts de l'Église primitive et en particulier la vie des apôtres Pierre et Paul ;
- le corpus paulinien (épîtres de Paul et de ses disciples), adressé aux premières communautés chrétiennes (Épîtres « ecclésiastiques ») puis à des responsables (Épîtres « pastorales »), où sont prodigués enseignement, conseils et éclaircissements sur la nouvelle foi ;
- l’Épître aux Hébreux, d'un auteur inconnu, qui explique l'Ancien Testament à la lumière de l'œuvre de Jésus ;
- Les épîtres universelles ou « catholiques » attribuées aux premiers disciples (Jacques « frère de Jésus », Pierre, Jean, Jude « frère de Jésus ») ;
- l'Apocalypse, qui signifie « révélation », prophétie sur la fin des temps.
Quatre Évangiles
1. Évangile selon Matthieu
L'Évangile selon Matthieu (Τὸ κατὰ Ματθαῖον εὐαγγέλιον) est le premier dans l'ordre canonique des quatre Évangiles canoniques contenus dans le Nouveau Testament7. Il est attribué par la tradition chrétienne à l'apôtre Matthieu, collecteur d'impôts devenu disciple de Jésus-Christ, mais cette attribution n'est pas reconnue par les historiens. En tout état de cause, ce texte date des années 70-80 ou 75-90, selon les chercheurs, et semble provenir d'Antioche, où vivait l'une des toutes premières communautés chrétiennes. Cet évangile s'adresse avant tout aux Juifs pour leur démontrer à l'aide de l'Ancien Testament que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu et l'Emmanuel (« Dieu avec nous ») depuis le début, le fils de David, l'héritier de tous les rois d'Israël et le Messie qu'ils espéraient. Dès l'entrée, Jésus est présenté comme Sauveur (cf. Mt 1,21), Emmanuel (1,23), roi (2,2), Messie ou Christ (2,4), Fils de Dieu (2,15), en accomplissement de toutes les prophéties. Le nom de fils de David, qui lui est associé et qui revient en dix occurrences8, présente Jésus comme le nouveau Salomon : en effet, Jésus s'exprime comme la Sagesse incarnée. En vertu du titre de Fils de l'homme, qui parcourt l'évangile, et qui provient du prophète Daniel, Jésus se voit doté de l'autorité divine sur le Royaume de Dieu, aux cieux comme sur la terre.
2. Évangile selon Marc
L'Évangile selon Marc (Τὸ κατὰ Μάρκον εὐαγγέλιον) est le deuxième (par sa place) des quatre Évangiles canoniques et aussi le plus bref9. Il est très probablement le plus ancien, avec une date de rédaction située en 65-70 ou 65-75 selon les chercheurs. La tradition chrétienne attribue sa rédaction à Marc, un compagnon de Paul puis de Pierre. Le personnage de Marc est mentionné dans le Nouveau Testament, notamment dans les Actes des Apôtres et les épîtres de Paul et de Pierre. Cependant, pour les historiens, l'historicité de Marc est difficile à cerner. Cet Évangile a pour particularité de présenter deux « finales » successives dans son seizième et dernier chapitre : l'une où les Saintes Femmes gardent le secret sur la Résurrection de Jésus et l'autre où elles l'annoncent.
3. Évangile selon Luc
L'Évangile selon Luc (Τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον) a pour auteur Luc (médecin et selon la tradition chrétienne, compagnon de Paul)10. C'est le plus long des quatre Évangiles retenus dans le Nouveau Testament. Il raconte la vie du Christ, même s'il ne l'a pas connu personnellement. Rédigé vers 80-90, il est contemporain de l'Évangile selon Matthieu mais les exégètes s'accordent à estimer que ces deux évangélistes ont écrit séparément, sans s'influencer. En revanche, selon la théorie des deux sources aujourd'hui acceptée par la quasi-totalité des spécialistes, Luc et Matthieu ont utilisé les mêmes sources, à savoir l'Évangile selon Marc et un recueil de paroles de Jésus nommé « Source Q » par les historiens. Luc a composé également les Actes des Apôtres, qui sont la suite de son évangile et narrent les débuts de l'Église chrétienne11. Les deux livres sont dédiés à « Théophile » (« ami de Dieu »), personnage réel ou symbole de tous les « amis de Dieu ». Le fait que Luc soit l'auteur de ces deux textes est admis par les historiens, non pas en raison de la dédicace ni même parce que le livre des Actes se présente comme la suite de l'évangile lucanien, mais parce que leurs styles littéraires sont identiques11 et qu'ils constituent un « ensemble littéraire à deux volets, dont l'homogénéité littéraire est avérée »12. Les deux ouvrages sont à dater des années 80-90.
4. Évangile selon Jean
L’Évangile selon Jean (en grec Τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιον, To kata Iōánnēn euangélion) est le dernier et le plus tardif des quatre évangiles du Nouveau Testament. La tradition l'a attribué à l'un des disciples de Jésus, l'apôtre Jean de Zébédée. Cette attribution est rejetée par la plupart des historiens modernes, pour lesquels ce texte provient d'un auteur anonyme, ou d'une communauté johannique, et date de la fin du ier siècle. L'hypothèse d'un Jean le Presbytre, distinct de Jean le fils de Zébédée, a été défendue par quelques exégètes13, mais, en l'absence de témoignage explicite dans la tradition ou d'allusion dans le quatrième évangile lui-même, cette théorie ne parvient guère à convaincre14.Cet évangile se démarque des trois synoptiques par des différences notables, notamment par sa composition, sa chronologie, son style, son contenu, sa théologie, et probablement par ses sources15.Sur le plan de la doctrine trinitaire, cet évangile est le plus important en matière de christologie, car il énonce la divinité de Jésus16.
Actes des Apôtres
Le récit des Actes des Apôtres, cinquième livre du Nouveau Testament, est la seconde partie de l’œuvre dédicacée à Théophile et rédigée par Luc, la première partie étant l'Évangile selon Luc17. Le récit débute avec l'Ascension suivie de la Pentecôte et relate les débuts de l'Église primitive qui se constitua autour des Apôtres à Jérusalem et se répandit ensuite en Judée, Galilée et Samarie et dans les communautés juives de la diaspora, avant de se séparer d'elles.
Épîtres de Paul
Parmi les Épîtres de Paul, 13 sont explicitement attribuées à Paul (l'Épître aux Hébreux étant anonyme)18:Saint Paul en prison, par Rembrandt, 1627.
Épître aux Romains (Rm)
Première épître aux Corinthiens (1 Co)
Deuxième épître aux Corinthiens (2 Co)
Épître aux Galates (Ga)
Épître aux Éphésiens (Ép)
Épître aux Philippiens (Ph)
Épître aux Colossiens (Col)
Première épître aux Thessaloniciens (1 Th)
Deuxième épître aux Thessaloniciens (2 Th)
Première épître à Timothée (1 Tm)
Deuxième épître à Timothée (2 Tm)
Épître à Tite (Tt)
Épître à Philémon (Phm)
Seules 7 d'entre elles sont jugées authentiques par la majorité des historiens : Rm, 1 Co, 2 Co, Ga, Ph, 1 Th et Phm. On les appelle « épîtres proto-pauliniennes »19. Les autres sont les 3 « épîtres deutéro-pauliniennes », écrites par des disciples proches de Paul (Ép, Col et 2 Th), et enfin les 3 « épîtres trito-pauliniennes » ou « pastorales », dues à des disciples plus tardifs (1 Tm, 2 Tm et Tt)19,20. On peut grouper ces 13 épîtres selon leurs thèmes :
lettres à dominante eschatologique (les deux épîtres aux Thessaloniciens ; la première aux Corinthiens) ;
lettres traitant de l'actualité du salut et de la vie des communautés (les deux lettres aux Corinthiens, lettres aux Galates, aux Philippiens et aux Romains) ;
lettres dites « de captivité » (l'épître à Philémon date de cette époque) qui parlent du rôle cosmique du Christ (Col ; Eph) ;
lettres dites « pastorales », traitant de l'organisation des communautés (épîtres 1 et 2 à Timothée et celle à Tite).
Épîtres universelles
Les Épîtres universelles ou Épîtres catholiques viennent immédiatement après les Épîtres de Paul. Ce sont une épître de Jacques, deux de Pierre, trois de Jean et une de Jude21. On les appelle universelles ou catholiques car elles étaient adressées à un public plus large que celui des épîtres de Paul, c'est-à-dire à l'Église entière ou universelle au lieu d'une église purement locale comme celle d'Éphèse ou de Corinthe. Les Épîtres catholiques font partie du canon protestant aussi bien que de celui des Églises catholique et orthodoxe.
Apocalypse
L’Apocalypse ou Apocalypse de Jean, est le dernier livre du Nouveau Testament canonique22.L'œuvre a été composée vers la fin du ier siècle23. L'auteur dit lui-même se nommer Jean, il est censé résider à Patmos au moment de l’écriture du texte, et la tradition chrétienne l'a souvent identifié à l'apôtre Jean fils de Zébédée ou à Jean le Presbytre. Cependant, l'exégèse historico-critique évoque le plus souvent une « communauté johannique » établie à Éphèse. C'est un texte adressé à sept Églises d'Asie mineure (autour d'Éphèse) qui les encourage face aux persécutions romaines (ou tout au moins, aux pièges de l'idolâtrie), et qui décrit en termes symboliques les grandes étapes (ou épreuves) qui doivent précéder le retour du Christ.
+ + +
SOURCES :
La Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
Listes des livres de la Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_livres_de_la_Bible
Ancien Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_Testament
Nouveau Testament
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau_Testament
Liste des livres de la Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_livres_de_la_Bible
Pentateuque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentateuque
Chronologie du Pentateuque (Ancien Testament)
https://www.bibliquest.net/Remmers/Remmers-Chronologie_biblique.htm
Chronologie du Pentateuque (les 5 premiers livres de Moise (ou "la Torah") - Ancien Testament)
https://www.bibliquest.net/Remmers/Remmers-Chronologie_biblique.htm
Livres deutérocanoniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Livres_deut%C3%A9rocanoniques
Septante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septante
Version Septante de la Bible en ligne :
https://www.levangile.com/Affichage-Multi-Bible.php
Vulgate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vulgate
Version Vulgate de la Bible en ligne :
https://www.levangile.com/Affichage-Multi-Bible.php
L'histoire de la Bible - Survol d'une grande épopée &
(Les moyens techniques de transmission de la Bible)
https://www.lirelabible.net/histoire.php#annexe2
Qui sont les auteurs des livres de la Bible ?
https://www.gotquestions.org/Francais/Auteurs-Bible.html
Introduction des 8 familles de la bible & différences entre elles
https://www.bibliorama.org/introduction-du-classement-des-bibles-en-8-familles/
Les traductions françaises de la Bible (Bibliorama)
https://www.bibliorama.org/les-traductions-francaises-de-la-bible/
Traductions de la Bible en français
https://fr.wikipedia.org/wiki/Traductions_de_la_Bible_en_fran%C3%A7ais
Lexique
https://www.bibliorama.org/lexique/
Atlas bibliques
https://www.bibliorama.org/atlas-bibliques/
Lire la Bible :
Version : La Bible Catholique Crampon 1923 ("BCC")
https://www.bible.com/fr/bible/504/MAT.6.BCC1923
http://labiblecrampon.free.fr/
https://www.bibliorama.org/bible/la-bible-crampon/
https://lueur.org/bible/versions/crampon.html
Pour télécharger La Bible Catholique Crampon 1923 ("BCC") :
https://confrontationswgod.blogspot.com/2018/01/telecharger-la-sainte-bible-crampon.html#ambil
Le Tanakh (Bible hébraïque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tanakh
La Torah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Torah
Nevi'im
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nevi%27im
Ketouvim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ketouvim
Les traductions françaises de la Bible
https://www.bibliorama.org/les-traductions-francaises-de-la-bible/
Lexique
https://www.bibliorama.org/lexique/
Atlas bibliques
https://www.bibliorama.org/atlas-bibliques/
Codex Sinaiticus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Sinaiticus
Pour faire une recherche dans le Codex Sinaiticus :
http://www.codex-sinaiticus.net/en/manuscript.aspx
Portail : Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Christianisme
La Bible Crampon (Bibliorama)
https://www.bibliorama.org/bible/la-bible-crampon/
Augustin Crampon : Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Augustin_Crampon
Liens pour lire la Bible :
Version : La Bible Catholique Crampon 1923 ("BCC")
https://www.bible.com/fr/bible/504/MAT.6.BCC1923
http://labiblecrampon.free.fr/
https://www.bibliorama.org/bible/la-bible-crampon/
